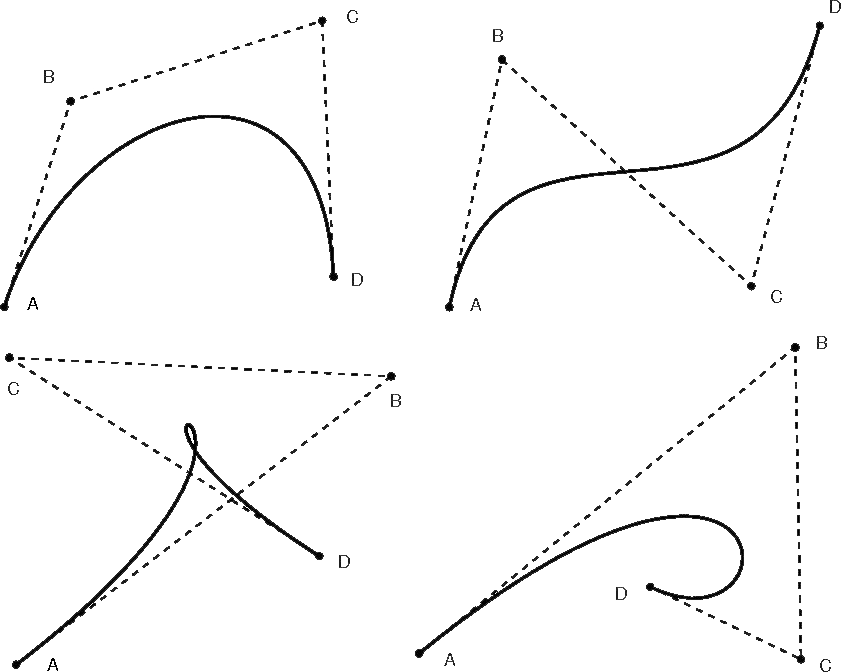Méta-morphose, figure archi-cinématographique de la modification.
carnet de recherche
Article à paraître dans la revue Images Secondes n°2, “Puissances architectoniques du cinéma”
Sous la direction d’Éline Grignard et Lydie Delahaye.
Le morphing, ou morphose, se présente a priori comme un simple procédé
technique, un effet spécial couramment utilisé dans les fictions cinématographiques.
Une
brève étude généalogique de cette figure — depuis les métamorphoses de l’âge
baroque jusqu’à leurs équivalents numériques — permet pourtant d’interroger le
sens et les finalités de la trans-formation, telle qu’elle s’opère déjà dans
d’autres arts, avant et hors le cinéma, dans l’architecture en particulier. Car
le temps et l’espace sont, dans une métamorphose, des données indéfiniment
réversibles : le temps est un vecteur permettant la mutation, et la transition
d'un espace vers un autre, tout comme la différence spatiale entre deux entités
permet d’en faire surgir du temps. Parce qu’elle est à la fois spatiale et
temporelle, la morphose est donc une opération archi-cinématographique. Elle
inquiète (positivement) les rapports entre architecture et cinéma et plus
encore.
![]()